Il y a un mois, le président de la « valeur travail » perdait l’élection qui aurait pu lui offrir un second mandat à la tête de la République française. Ressourcé après des vacances plus ou moins méritées au Maroc (« Marrakech qu’il a fait là-bas ? », dirait l’autre), notre Petit père du peuple vient de rentrer à Paris pour prendre possession de ses nouveaux bureaux. Tout le monde, ou du moins tous les journalistes de la place, se posent désormais la question : mais comment va-t-il occuper son temps ?
Au lieu de nous perdre en conjectures et d’ajouter au déferlement insensé d’élucubrations futiles, nous souhaitons nous montrer plus constructifs : nous allons nous-mêmes proposer au déjà retraité ce qu’il pourrait faire dans les années qui viennent. Et ce qu’il devrait encourager ses concitoyens à faire à sa suite.
C’est bien simple : puisqu’il n’a plus à mettre toute son énergie à manigancer et jouer des coudes afin de se maintenir au sommet, puisqu’il n’est plus d’enjeu politique qui puisse encore obscurcir ses facultés de jugement, il lui est enfin possible de réfléchir sereinement aux idées qu’il a défendues aveuglément pendant si longtemps. Il ne lui est plus besoin de choisir ses opinions en fonction des ses objectifs stratégiques : il peut enfin exercer ses facultés de raisonnement pour se forger un avis personnel sur quelques questions importantes.
Or le premier sujet d’étude que nous recommandons à notre philosophe en herbe est bien celui qui l’a obsédé pendant toutes ces années : le travail. Le dogme du travail, devrions-nous dire. Et pour aider notre ex-hyperactif dans ses pondérations, nous soumettrons à sa raison éclairée deux textes courts et percutants, délicieusement anticonformistes :
- Le Droit à la paresse, de Paul Lafargue
- Eloge de l’oisiveté, de Bertrand Russell (In Praise of Idleness en version originale, celle que nous allons préférer, histoire de travailler notre anglais !)
[Note au lecteur : tout ce qui suit peut être lu intégralement, en prenant le temps de considérer les extraits cités, ou bien, pour les plus paresseux d'entre vous, beaucoup plus vite, en sautant les citations - si elles n’apportent pas d’idées supplémentaires, elles illustrent néanmoins avec plus de précision les pensées de chaque auteur]
1. Les auteurs et leur pamphlet
Paul Lafargue est un socialiste français du 19e siècle, mais entendons-nous bien : par « socialiste », il faut entendre, dans notre langue moderne, qu’il était communiste. Les idées du talentueux polémiste empruntent en effet davantage à la pensée de Marx et Engels qu’aux éléments de langage de notre nouveau Président. Et pour cause : né en 1842 à Cuba (quel visionnaire, quelle avance sur ses camarades !), Lafargue rencontre les deux auteurs du Manifeste du parti communiste à Londres en 1865, et poussera la sympathie marxiste jusqu’à épouser Laura, la fille de Karl. S’en suivent des années de participation à la vie politique française, fidèle à cette couleur rouge qu’il rêvait de voir remplacer les drapeaux tricolores.Rédigé en 1880 en réponse aux revendications du droit au travail, Le Droit à la paresse est son pamphlet le plus connu, critique au vitriol de la « folie furibonde du travail » dont témoignent à ses yeux les prolétaires, abrutis par le système capitaliste, et pervertis par l’ignoble morale qu’il insuffle :
« Et cependant, le prolétariat, la grande classe qui embrasse tous les producteurs des nations civilisées, la classe qui, en s’émancipant, émancipera l’humanité du travail servile et fera de l’animal humain un être libre ; le prolétariat, trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s’est laissé pervertir par le dogme du travail. »Direct et véhément, le texte est d’une étonnante modernité ; il y a quelque chose d’effrayant à voir certaines de ses analyses décrire si exactement la réalité que nous connaissons encore aujourd’hui (obsolescence programmée, cyclicité des crises de surproduction, utilité des guerres pour l’obtention de débouchés économiques…).
Surtout, comme nous allons le voir, Lafargue présente un projet de société communiste très éloigné de l’idéologie martelée (et faucillée) par les dirigeants de l’URSS ou de l’actuelle Chine : sa société idéale ne tire pas sa force d’un productivisme industriel forcené, d’un viol continuel et répété d’une Mère nature offrant gratuitement ses ressources, mais d’un rationnement raisonnable du travail, afin que chacun connaisse la jouissance et profite gaillardement des fruits de sa besogne.
Pourtant, il n’aura pas échappé à Bertrand Russell que, de l’autre côté du Rideau de fer, la doctrine du Parti n’aura jamais renoncé au culte du travail. Ainsi renvoie-t-il dos à dos soviétiques et capitalistes :
« Industry, sobriety, willingness to work long hours for distant advantages, even submissiveness to authority, all these reappear; moreover authority still represents the will of the Ruler of the Universe, Who, however, is now called by a new name, Dialectical Materialism. »Bertrand Russell, dont vous pourrez vous amuser à compter les photos sans pipe à la bouche, est un homme comme on les aime sur ce blog (pour un peu, Lord Tesla a failli porter son nom !). Entre autres accomplissements majeurs :
- Mathématicien, il apporte des développements majeurs aux théories de la logique
- Promoteur du rationalisme, il s’avoue agnostique et défend le scepticisme
- Moraliste engagé, il lance avec Jean-Paul Sartre le premier « tribunal d’opinion » pour « juger les crimes de guerre » des États-Unis au Vietnam
- Philosophe et écrivain, il obtient un prix Nobel de littérature en 1950, en particulier pour sa défense d’un idéal humaniste et comme libre penseur
« One of the painful things about our time is that those who feel certainty are stupid, and those with any imagination and understanding are filled with doubt and indecision »Dans son Éloge de l’oisiveté, c’est au nom du progrès et de la justice sociale qu’il dénonce l’acharnement au travail : non seulement les améliorations techniques permettent de diminuer les besoins en capital humain à niveau de production constant, mais une répartition du travail et des loisirs plus équitable est possible.
« I want to say, in all seriousness, that a great deal of harm is being done in the modern world by belief in the virtuousness of work, and that the road to happiness and prosperity lies in an organized diminution of work. »Comme tout humaniste qui se respecte, Russell songe aux générations futures, et son discours cible donc les jeunes :
« I hope that, after reading the following pages, the leaders of the YMCA [auberges de jeunesse internationales] will start a campaign to induce good young men to do nothing. If so, I shall not have lived in vain. »[Note : nous pouvons le rassurer sur ce point ; une cinquantaine d’années après la publication de son texte, des "Gens du Village" douteusement revêtus de l’uniforme-type associé à divers corps de métier – même celui de cow-boy ou d’Indien – se feraient une joie d’exhorter les jeunes hommes du monde entier à passer du bon temps dans un YMCA ;) !]
Que dire de plus pour vous inciter à parcourir ces deux textes ? Que les deux polémistes étaient plutôt « du bon côté de la barrière », pour ainsi dire ; étant donné leurs conditions de vie, pour eux, encourager les classes laborieuses à se détourner du travail, c’est presque mordre la main qui les nourrit ! S’ils n’ont rien à y gagner, voire plus à y perdre, leur parole mérite d’être entendue, puisqu’elle a donc plus de chances d’émaner d’une réflexion personnelle et désintéressée.
Enfin, Lafargue et Russell ont tous les deux un style décapant, témoignant d’un art consommé de l’ironie !
- L’un donne une nouvelle couleur à une expression passablement raciste, modifiée pour prendre en compte les fines allusions d’un ministre de l’Intérieur boutefeu : « c’est du travail d’Auvergnat »
« Par contre, quelles sont les races pour qui le travail est une nécessité organique ? Les Auvergnats ; les Écossais, ces Auvergnats des îles Britanniques ; les Gallegos, ces Auvergnats de l’Espagne ; les Poméraniens, ces Auvergnats de l’Allemagne ; les Chinois, ces Auvergnats de l’Asie. »
- L’autre redéfinit justement les notions de travail, de politique et de publicité :
« First of all: what is work? Work is of two kinds: first, altering the position of matter at or near the earth’s surface relatively to other such matter; second, telling other people to do so. The first kind is unpleasant and ill paid; the second is pleasant and highly paid. The second kind is capable of indefinite extension: there are not only those who give orders, but those who give advice as to what orders should be given. Usually two opposite kinds of advice are given simultaneously by two organized bodies of men; this is called politics. The skill required for this kind of work is not knowledge of the subjects as to which advice is given, but knowledge of the art of persuasive speaking and writing, i.e. of advertising. »
Eloge de l’oisiveté : tout un spectacle
2. Etude de texte
1) Le problème : l’acharnement au travail est la cause d’innombrables misères sociales et individuelles
Lafargue décrit ainsi la façon dont le travail abîme l’âme et le corps :« Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Comparez le pur-sang des écuries de Rothschild, servi par une valetaille de bimanes, à la lourde brute des fermes normandes, qui laboure la terre, chariote le fumier, engrange la moisson. Regardez le noble sauvage que les missionnaires du commerce et les commerçants de la religion n’ont pas encore corrompu avec le christianisme, la syphilis et le dogme du travail, et regardez ensuite nos misérables servants de machines. »En bon marxiste, il analyse la façon dont la gestion économique du travail génère de fréquentes crises de surproduction. Pour un peu, on se demanderait si ces crises ne sont pas causées intentionnellement par les détenteurs des moyens de production :
« Au lieu de profiter des moments de crise pour une distribution générale des produits et un gaudissement universel, les ouvriers, crevant de faim, s’en vont battre de leur tête les portes de l’atelier. [...] Et ces misérables, qui ont à peine la force de se tenir debout, vendent douze et quatorze heures de travail deux fois moins cher que lorsqu’ils avaient du pain sur la planche. Et les philanthropes de l’industrie de profiter des chômages pour fabriquer à meilleur marché. »[Note : aujourd'hui, la métonymie sonnera forcément antisémite (ce qui ne signifie pas que c'était le cas à l'époque), mais notons que Lafargue emploie le terme "le juif" pour désigner l'image d'un banquier lambda !]
Parce qu’en brandissant la menace du chômage d’une main, tout en proposant une logique du « c’est mieux que rien » de l’autre, les producteurs ont toute latitude pour faire pression sur les salaires :
« Les philanthropes acclament bienfaiteurs de l’humanité ceux qui, pour s’enrichir en fainéantant, donnent du travail aux pauvres. »
Hé ho, non, il n’y a rien de Joyeux dans le travail : c’est de l’exploitation de mineurs !
- Générer des envies artificielles
« [...] le grand problème de la production capitaliste n’est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces, mais de découvrir des consommateurs, d’exciter leurs appétits et de leur créer des besoins factices. »
- Programmer l’obsolescence (tout bien s’use, vieillit ou se démode en peu de temps)
« Tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l’écoulement et en abréger l’existence. Notre époque sera appelée l’ « âge de la falsification », comme les premières époques de l’humanité ont reçu les noms d’ « âge de pierre », d’ « âge de bronze », du caractère de leur production. Des ignorants accusent de fraude nos pieux industriels, tandis qu’en réalité la pensée qui les anime est de fournir du travail aux ouvriers, qui ne peuvent se résigner à vivre les bras croisés. »
- Envahir de nouveaux marchés…
« Puisque les ouvriers européens, grelottant de froid et de faim, refusent de porter les étoffes qu’ils tissent, de boire les vins qu’ils récoltent, les pauvres fabricants, ainsi que des dératés, doivent courir aux antipodes chercher qui les portera et qui les boira : ce sont des centaines de millions et de milliards que l’Europe exporte tous les ans, aux quatre coins du monde, à des peuplades qui n’en ont que faire. »
- … quitte à mener des guerres de conquête
« [...] les fabricants parcourent le monde en quête de débouchés pour les marchandises qui s’entassent ; ils forcent leur gouvernement à s’annexer des Congo, à s’emparer des Tonkin, à démolir à coups de canon les murailles de la Chine, pour y écouler leurs cotonnades. Aux siècles derniers, c’était un duel à mort entre la France et l’Angleterre, à qui aurait le privilège exclusif de vendre en Amérique et aux Indes. »Russell aboutit à des conclusions similaires, quoique de manière plus expéditive :
« But what will happen when the point has been reached where everybody could be comfortable without working long hours?A qui profite le crime ? Qui a le plus à gagner du travail des masses laborieuses ?
In the West, we have various ways of dealing with this problem. We have no attempt at economic justice, so that a large proportion of the total produce goes to a small minority of the population, many of whom do no work at all. Owing to the absence of any central control over production, we produce hosts of things that are not wanted. We keep a large percentage of the working population idle, because we can dispense with their labor by making the others overwork. When all these methods prove inadequate, we have a war: we cause a number of people to manufacture high explosives, and a number of others to explode them, as if we were children who had just discovered fireworks. By a combination of all these devices we manage, though with difficulty, to keep alive the notion that a great deal of severe manual work must be the lot of the average man. »
2) La cause : la valorisation du travail est un dogme absurde historiquement imposé par les puissants
Le travail n’a pas toujours bénéficié d’une image aussi positive.« Les Grecs de la grande époque n’avaient, eux aussi, que du mépris pour le travail ; aux esclaves seuls il était permis de travailler : l’homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l’intelligence. […] Les philosophes de l’Antiquité enseignaient le mépris du travail, cette dégradation de l’homme libre ; les poètes chantaient la paresse, ce présent des Dieux. »D’ailleurs, une certaine forme d’oisiveté et d’insouciance économique (chose certes plus aisée lorsqu’on n’a pas à s’inquiéter du niveau de son patrimoine) est à l’origine des grandes avancées de l’histoire humaine :
« The leisure class […] contributed nearly the whole of what we call civilization. It cultivated the arts and discovered the sciences; it wrote the books, invented the philosophies, and refined social relations. Even the liberation of the oppressed has usually been inaugurated from above. Without the leisure class, mankind would never have emerged from barbarism. »Jésus-Christ lui-même aurait enjoint ses disciples à la nonchalance, guidé en cela par l’exemple ultime que nous donna son Père :
« [...] après six jours de travail, il se repose pour l’éternité. »Pourtant, le message du Fils de Dieu aurait été dénaturé par l’Eglise dans le but de contraindre les hommes à travailler la terre au profit des puissants. Or, bien des siècles plus tard, lorsque la bourgeoisie récupère le pouvoir de la noblesse, elle se garde bien de remettre en cause le dogme du travail.
Ainsi Lafargue établit-il un parallèle entre la morale chrétienne et la morale capitaliste. Leurs représentants ont eu la même tendance à dénier aux travailleurs le droit à la jouissance et aux plaisirs, tout en prêchant que le salut dépendrait de l’ardeur au travail. Une élite a remplacé l’autre, une nouvelle religion s’est substituée à l’ancienne, mais le culte du labeur continue d’être instrumentalisé par la classe au pouvoir pour imposer l’ « abstinence » et contraindre les pauvres à trimer pour elle.
« La morale capitaliste, piteuse parodie de la morale chrétienne, frappe d’anathème la chair du travailleur ; elle prend pour idéal de réduire le producteur au plus petit minimum de besoins, de supprimer ses joies et ses passions, de le condamner au rôle de machine délivrant du travail sans trêve, ni merci. »Au lieu d’employer la force, les classes dirigeantes convertissent les masses au dogme du travail ; la diffusion de l’idéologie écarte la nécessité de recourir à la coercition.
« Travaillez, travaillez nuit et jour ; en travaillant, vous faites croître votre misère, et votre misère nous dispense de vous imposer le travail par la force de la loi. L’imposition légale du travail « donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit ; la faim, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse, incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l’industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants ». »Russell souligne également qu’avec le développement d’une « éthique du travail », le choix des travailleurs devient volontaire au lieu d’être contraint. Pourtant, en faisant ce choix, les travailleurs jouent contre leur propre intérêt :
« The conception of duty, speaking historically, has been a means used by the holders of power to induce others to live for the interests of their masters rather than for their own. »
Le syndrome de Stockholm du larbin
« The idea that the poor should have leisure has always been shocking to the rich. In England, in the early nineteenth century, fifteen hours was the ordinary day’s work for a man; children sometimes did as much, and very commonly did twelve hours a day. When meddlesome busybodies suggested that perhaps these hours were rather long, they were told that work kept adults from drink and children from mischief. »Le riche se méfie des libertés accordées au pauvre, et se protège en diffusant une morale compatible avec ses intérêts. Mais Russell trouve illogique de dénigrer la consommation :
« The man who invests his savings in a concern that goes bankrupt […] will be regarded as a victim of undeserved misfortune, whereas the gay spendthrift, who has spent his money philanthropically, will be despised as a fool and a frivolous person. »Car si l’acte de production est valorisé, comme peut-on décemment critiquer l’acte de consommation, qui en est la condition nécessaire ?
« Broadly speaking, it is held that getting money is good and spending money is bad. Seeing that they are two sides of one transaction, this is absurd; one might as well maintain that keys are good, but keyholes are bad. »Le travail n’est pas une fin en soi ; il n’est qu’un moyen de prétendre au bonheur :
« [...] without a considerable amount of leisure a man is cut off from many of the best things. There is no longer any reason why the bulk of the population should suffer this deprivation. »Ce que revendique Russell, c’est un droit égal des pauvres à s’adonner aux loisirs. Car les grands gagnants de la division sociale du travail sont donc les puissants, riches oisifs exploitant une main-d’œuvre paupérisée :
« [...] la classe capitaliste s’est trouvée condamnée à la paresse et à la jouissance forcée, à l’improductivité et à la surconsommation. »Mais sont-ils eux-mêmes épanouis et heureux ? Lafargue en doute :
« Pour remplir sa double fonction sociale de nonproducteur et de surconsommateur, le bourgeois dut non seulement violenter ses goûts modestes, perdre ses habitudes laborieuses d’il y a deux siècles et se livrer au luxe effréné, aux indigestions truffées et aux débauches syphilitiques, mais encore soustraire au travail productif une masse énorme d’hommes afin de se procurer des aides. »[Note : le polémiste français produit en effet des chiffres étonnants montrant que, d’après le recensement effectué en 1861 en Angleterre et au Pays de Galles, le nombre d’employés de la classe domestique était légèrement supérieur à celui des travailleurs agricoles, et similaire au nombre total de travailleurs des fabriques textiles et des mines de charbon et de métal. Bon, vous avez le droit de douter de la fiabilité des méthodes de calcul de l’époque, ceci dit.]
Finalement, le problème ne tient pas tant à la nature du travail, ou au fait de travailler, qu’à son inégale répartition entre riches et pauvres. Contraints au labeur face à des puissants qui ont les moyens et le loisir de ne pas se tuer à la tâche, eux, les pauvres ne font très concrètement qu’assister les riches dans leur oisiveté. Il est donc tout à fait stupide de leur part de réclamer un droit au travail. Ils commettent une erreur aberrante, en succombant ainsi à une illusion savamment entretenue.
Et le gendre de Karl Marx n’hésite pas à les tancer vertement ! Il faut dire que son goût pour les plaisirs et la jouissance semble très développé. Songez donc : il admire les peuples capables de sacrifier ceux de leurs membres qui ne profitent plus de la vie.
« Les Indiens des tribus belliqueuses du Brésil tuent leurs infirmes et leurs vieillards ; ils témoignent leur amitié en mettant fin à une vie qui n’est plus réjouie par des combats, des fêtes et des danses. Tous les peuples primitifs ont donné aux leurs ces preuves d’affection […]. Combien dégénérés sont les prolétaires modernes pour accepter en patience les épouvantables misères du travail de fabrique ! »Si cette conception peut vous paraître cynique, sachez que Lafargue ne se contente pas de mots. A l’évidence, le socialiste « dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit » ; se suicidant à 69 ans avec sa femme, il justifiera son geste dans une courte lettre :
« Sain de corps et d’esprit, je me tue avant que l’impitoyable vieillesse qui m’enlève un à un les plaisirs et les joies de l’existence et qui me dépouille de mes forces physiques et intellectuelles ne paralyse mon énergie, ne brise ma volonté et ne fasse de moi une charge à moi et aux autres. »On aimerait voir autant de sollicitude de la part des retraités représentant un fardeau extraordinaire pour leur famille, leurs finances et celles de l’État. Ah, bien sûr, ça aide de ne pas être encombré d’une morale religieuse sacralisant absolument la vie, à tout prix, même sous une forme totalement dégénérée…
3) Solution : réduire radicalement le temps de travail, et le partager
Aucun des deux auteurs ne condamne complètement le travail : utile, il peut même se révéler épanouissant et libérateur, si tant est qu’il soit appréhendé comme un moyen plutôt qu’une fin. Cependant, Lafargue et Russell envisagent tous deux une diminution effective du nombre d’heures travaillées :- 3h par jour suffisent pour Lafargue
« […] le travail ne deviendra un condiment de plaisir de la paresse, un exercice bienfaisant à l’organisme humain, une passion utile à l’organisme social que lorsqu’il sera sagement réglementé et limité à un maximum de trois heures par jour. »
- 4h par jour pour Russell
« If the ordinary wage-earner worked four hours a day, there would be enough for everybody and no unemployment — assuming a certain very moderate amount of sensible organization. »Pourquoi se ménager ? Hé bien je vais vous le dire, Madame Chazal : il faut travailler moins pour vivre plus. Un tel système est-il viable ? Oui, bien sûr.
D’abord, nous n’avons pas tous besoin de travailler pour assurer la satisfaction des besoins de l’ensemble de la population. La Seconde guerre mondiale l’a démontré :
« The war showed conclusively that, by the scientific organization of production, it is possible to keep modern populations in fair comfort on a small part of the working capacity of the modern world. If, at the end of the war, the scientific organization, which had been created in order to liberate men for fighting and munition work, had been preserved, and the hours of the week had been cut down to four, all would have been well. Instead of that the old chaos was restored, those whose work was demanded were made to work long hours, and the rest were left to starve as unemployed. Why? Because work is a duty, and a man should not receive wages in proportion to what he has produced, but in proportion to his virtue as exemplified by his industry. »
Ensuite, plus généralement, l’amélioration des techniques permet de
consacrer de moins en moins de ressources à la production d’un même
nombre de biens ou services :
« À mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l’homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, l’Ouvrier, au lieu de prolonger son repos d’autant, redouble d’ardeur, comme s’il voulait rivaliser avec la machine. Ô concurrence absurde et meurtrière !Ce que proposent nos deux compères, c’est tout simplement de toucher les dividendes du progrès. Si le développement des machines permet de réduire les besoins en capital humain à niveau de production constant, il faut redonner aux travailleurs le temps ainsi économisé, au lieu de l’affecter à un surcroît de production. L’introduction de robots sur les chaînes de montage est problématique si l’on considère que les ouvriers remplacés doivent trouver du travail ailleurs, mais pas si le bénéfice de cette évolution leur est accordé sous forme de temps libre (à salaire égal, ou faiblement amputé).
[...] la passion aveugle, perverse et homicide du travail transforme la machine libératrice en instrument d’asservissement des hommes libres : sa productivité les appauvrit. »
« Abêtis par leur vice, les ouvriers n’ont pu s’élever à l’intelligence de ce fait que, pour avoir du travail pour tous, il fallait le rationner comme l’eau sur un navire en détresse. »De fait, une telle (ré)organisation permet également de partager l’aptitude au loisir :
« Modern technique has made it possible for leisure, within limits, to be not the prerogative of small privileged classes, but a right evenly distributed throughout the community. The morality of work is the morality of slaves, and the modern world has no need of slavery. »Sous réserve de suivre leurs prescriptions, les deux auteurs nous promettent une société idéale. Au niveau individuel, l’accroissement du bonheur et le sentiment de justice sociale se traduiront par un regain de vigueur et de bienveillance, gage de bien-être collectif. Les hommes se détourneront alors des guerres…
« Ordinary men and women, having the opportunity of a happy life, will become more kindly and less persecuting and less inclined to view others with suspicion. The taste for war will die out, partly for this reason, and partly because it will involve long and severe work for all. »… et, d’une manière générale, la tendance à la conflictualité s’émoussera :
« La bourgeoisie, déchargée alors de sa tâche de consommateur universel, s’empressera de licencier la cohue de soldats, de magistrats, de figaristes, de proxénètes, etc., qu’elle a retirée du travail utile pour l’aider à consommer et à gaspiller. [...] Les rentiers, les capitalistes, tout les premiers, se rallieront au parti populaire, une fois convaincus que, loin de leur vouloir du mal, on veut au contraire les débarrasser du travail de surconsommation et de gaspillage dont ils ont été accablés dès leur naissance. »Dans le monde utopique décrit par Lafargue et Russel, il y aura plein de choses à faire pour s’occuper. Par exemple :
« En régime de paresse, pour tuer le temps qui nous tue seconde par seconde, il y aura des spectacles et des représentations théâtrales toujours et toujours ; c’est de l’ouvrage tout trouvé pour nos bourgeois législateurs. On les organisera par bandes courant les foires et les villages, donnant des représentations législatives. »Plus sérieux, l’humaniste anglais explique que le temps retrouvé doit permettre à chacun de s’adonner aux activités personnelles qui lui sembleront conformes à ses attentes et ses talents. Ce qui nécessite évidemment une certaine éducation, ne serait-ce que pour apprendre à se détourner des plaisirs les plus passifs, et à user de son industrie au profit d’activités plus engageantes :
« The wise use of leisure, it must be conceded, is a product of civilization and education. A man who has worked long hours all his life will become bored if he becomes suddenly idle. […] It is an essential part of any such social system that education should be carried further than it usually is at present, and should aim, in part, at providing tastes which would enable a man to use leisure intelligently. I am not thinking mainly of the sort of things that would be considered ‘highbrow’. […] The pleasures of urban populations have become mainly passive: seeing cinemas, watching football matches, listening to the radio, and so on. This results from the fact that their active energies are fully taken up with work; if they had more leisure, they would again enjoy pleasures in which they took an active part. »Par exemple, le temps libre peut fournir l’occasion de mener de longues recherches sur les sujets qui nous passionnent – et de bloguer comme pas permis
« In a world where no one is compelled to work more than four hours a day, every person possessed of scientific curiosity will be able to indulge it, and every painter will be able to paint without starving, however excellent his pictures may be. »
Conclusion : des chômeurs, quand y en a un, ça va…
C’est quand y en a beaucoup qu’il faut se demander s’il n’y pas un problème[Note : ô surprise ! Ayant retrouvé la vidéo de la fameuse vanne de notre ancien ministre de l'Intérieur, nous avons bien écouté la bande-son, et tenons à souligner que la retranscription la plus communément admise a toujours été fautive : la phrase ne débute pas par "quand y en a un", mais "dès qu'y en a un" ! Bon, évidemment, ça ne change pas grand-chose au sens du jugement exprimé.]
Paul Lafargue et Bertrand Russell critiquent la prégnance d’une représentation du travail qui autorise une classe de riches oisifs à exploiter et asservir la masse des travailleurs. La conception de la vie et du plaisir des deux auteurs, ainsi que leur conscience égalitariste, les poussent à revendiquer à la fois une réduction du temps de travail et une meilleure répartition de ce travail entre tous les travailleurs, au nom de la justice sociale.
Sources et liens pour aller plus loin :
- L’Art d’ignorer les pauvres, de John Kenneth Galbraith, qui dénonce d’autres mécanismes par lesquels nous nous épargnons toute mauvaise conscience quant à l’ordre économique établi
- Un dossier du site d’Arrêt sur images a été consacré au travail ; un article analysait le Droit à la paresse juste avant la tenue d’un débat sur les retraites opposant le député Gérard Filoche, grand opposant à la réforme des retraites voulue par Nicolas Sarkozy, et Aurélie Filipetti, actuelle ministre de la Culture et de la Communication !
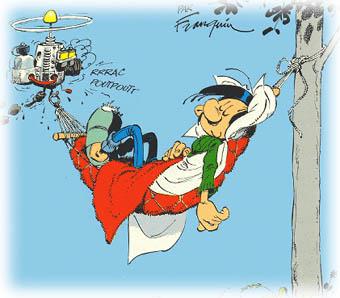







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.